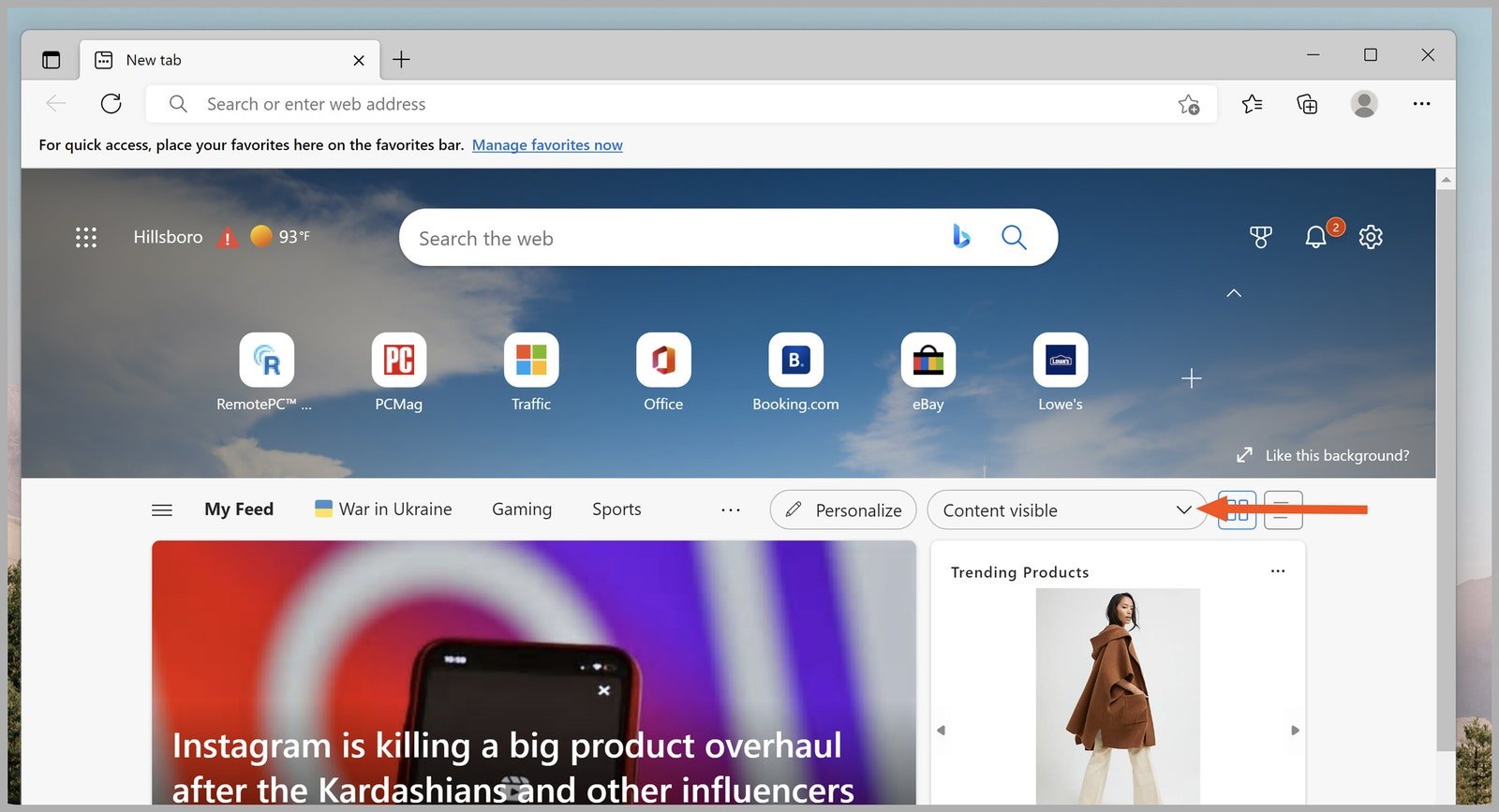« Que devons-nous faire de nos collègues russes ? demanda le scientifique principal dans l’assistance. C’est le début de l’été et 100 degrés à Chicago. Je donnais un discours au Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), le premier centre de recherche en physique des particules des États-Unis et mon ancien lieu de travail. Mon discours s’est concentré sur l’expérience asiatique-américaine et l’impact de la détérioration des relations américano-chinoises sur la science, mais pour beaucoup dans l’auditorium, l’invasion russe de l’Ukraine commandait une urgence plus aiguë.
Quelques jours après le début du conflit, le 24 février, le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, partenaire de longue date du Laboratoire Fermi, a interrompu toute nouvelle collaboration avec des institutions et des particuliers en Russie et en Biélorussie. L’organisation a annoncé en juin son intention de rompre les liens avec les deux pays une fois leurs accords de coopération actuels expirés en 2024. D’autres organisations internationales ont pris des mesures similaires ou plus drastiques. Le Conseil de l’Arctique, un forum intergouvernemental de huit États arctiques, a suspendu ses travaux en mars et reprend cet été des recherches limitées sans la participation de la Russie, un revers potentiellement dévastateur pour la science du climat. L’Agence spatiale européenne a mis fin à sa coopération avec la Russie, immobilisant le premier rover européen sur Mars, qui devait embarquer à bord d’une fusée russe vers la planète rouge plus tard cette année. Pendant un instant, il a semblé que la Station spatiale internationale résisterait aux événements sismiques sur Terre. Cet espoir a été anéanti fin juillet, lorsque le chef de l’agence spatiale russe a déclaré que son pays quitterait le projet en 2024.
Des calottes glacées de la Terre aux confins de l’espace, la lame tranchante de la guerre s’est fendue à travers des alliances universitaires déjà effilochées sous les tensions de la pandémie et de la géopolitique, exposant une question brûlante sans réponse facile. Lors de conversations avec des amis et des collègues aux États-Unis et en Europe, j’ai ressenti une frustration collective proche de l’impuissance. Tout le monde déplore l’invasion et s’accorde sur la nécessité de faire quelque chose pour aider l’Ukraine, et que continuer à faire comme si de rien n’était face à une telle calamité serait moralement indéfendable. Mais à part publier des déclarations et fournir de l’aide, quelles actions concrètes le monde universitaire et la communauté scientifique peuvent-ils entreprendre vis-à-vis de la Russie ?
Beaucoup me disent que la décision n’est pas entre leurs mains : « C’est de la politique. Les laboratoires et leur personnel doivent respecter les sanctions gouvernementales et les règles des agences de financement, dont certaines interdisent de collaborer avec des collègues en Russie ou d’accréditer des institutions russes dans des articles co-écrits. Certains regrettent que les scientifiques russes qui ne soutiennent pas activement l’invasion soient injustement ostracisés. Un scientifique, qui a grandi dans l’ex-Union soviétique avant d’émigrer vers l’Occident, a avancé un argument convaincant selon lequel les gens dans les démocraties ne devraient pas aider à faire avancer la science dans les régimes autoritaires ; cela ne ferait que renforcer les dictateurs, qui utilisent la technologie à des fins destructrices. Le scientifique n’a pas visité son pays natal depuis des années et exhorte tous ses étudiants chinois à ne jamais retourner en Chine non plus.
Des milliers de scientifiques, de journalistes scientifiques et d’étudiants en Russie, ainsi que de nombreux autres membres de la diaspora russe, ont signé des lettres ouvertes condamnant le conflit. Parmi les personnes emprisonnées pour leur opposition se trouve le politicien et journaliste Vladimir Kara-Murza, dont le père a notoirement refusé un emploi formel en Russie soviétique en signe de répudiation contre le régime totalitaire. Ces actes courageux sont des étincelles d’espoir dans les longues nuits de guerre et d’oppression ; ils brisent également l’illusion que les gens ordinaires ne sont pas coupables des actions de l’État. Rejeter la responsabilité, c’est nier l’agence. Dans un monde injuste, le compromis est souvent une condition de survie.
Les points de vue variés envers leurs homologues russes de la part des scientifiques occidentaux – s’appuyer sur des directives officielles, prétendre que le peuple russe est impuissant ou évoquer une coupure complète – émanent tous d’une position commune : l’innocence du spectateur. Les bombes, les prisons et les purges sont imputées à un État abstrait et jetées dans un lieu étranger, malgré le fait que les villes allemandes sont alimentées au gaz russe, les banques suisses sont des refuges pour les copains de Poutine et les gouvernements apparemment démocratiques utilisent également la technologie pour nuire, y compris les nombreux conflits armés initiés par les États-Unis. L’insistance sur l’innocence empêche une compréhension claire des systèmes de violence et d’injustice qui se chevauchent et qui ne se limitent jamais à une guerre, un pays ou un modèle de gouvernement. Alors que le monde se fracture le long des divisions politiques et que le milieu universitaire se retrouve sur les lignes de fracture, la façon dont nous percevons et réagissons à l’autre désigné concerne finalement nous-mêmes : qui nous sommes, où nous en sommes et quel genre d’avenir nous recherchons.